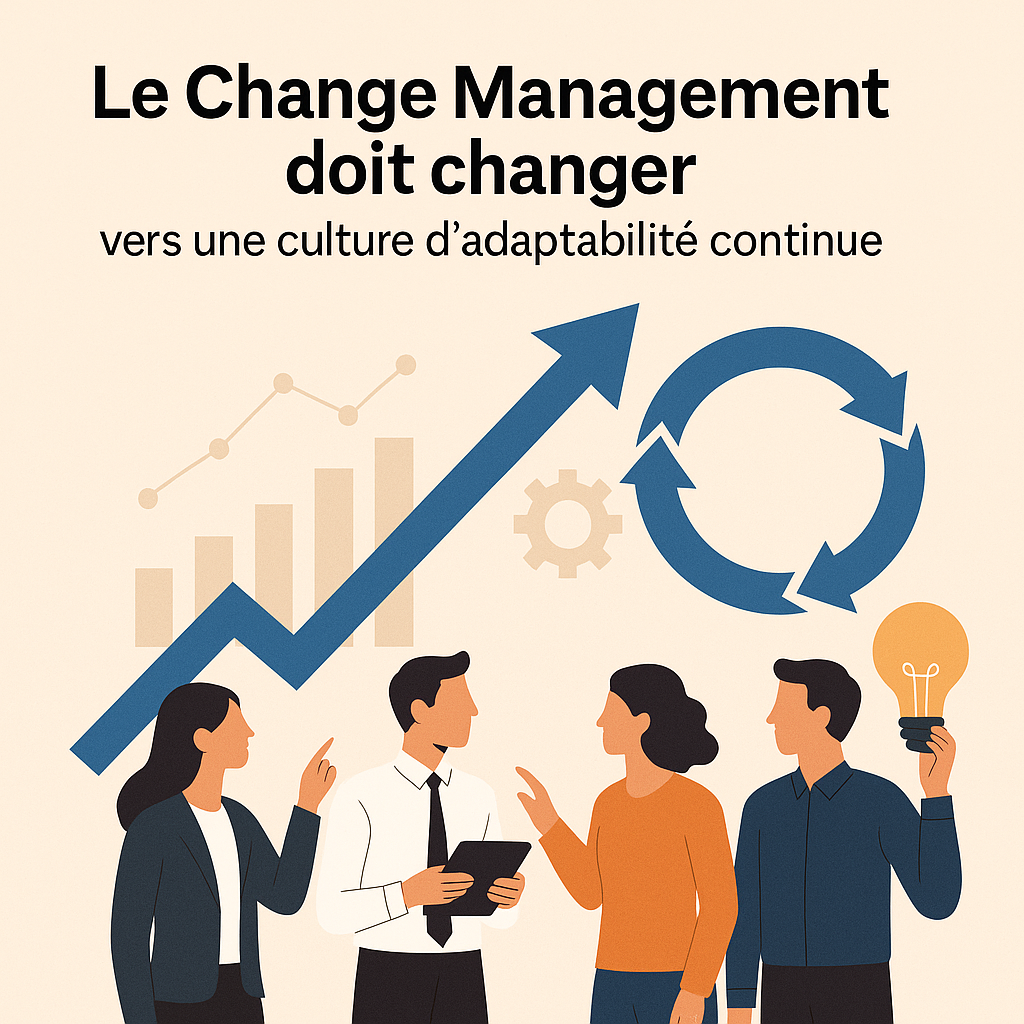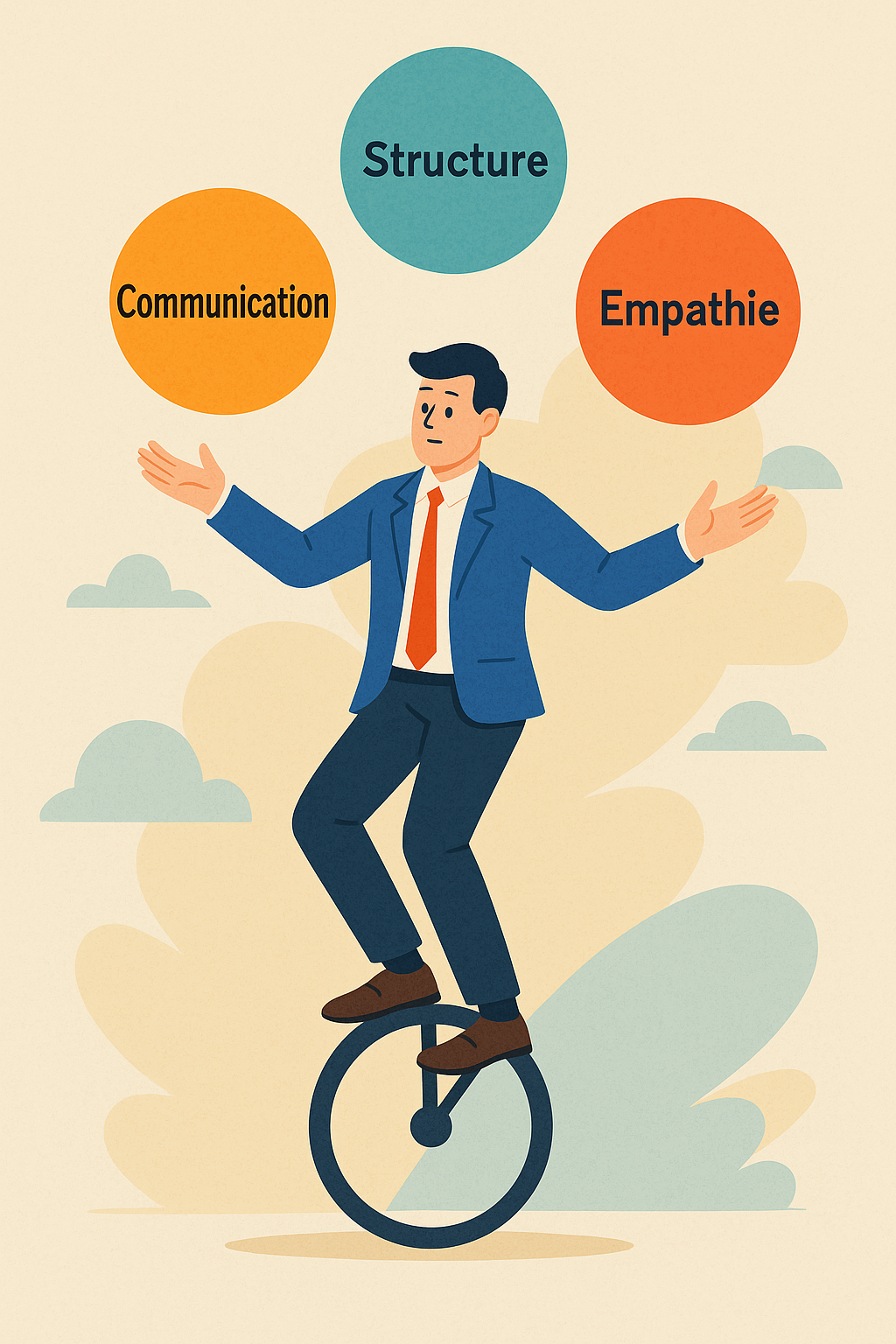Le tiraillement du manager : entre performance et bien-être des équipes
Le tiraillement permanent des managers
Dans les entreprises, les managers vivent souvent une pression à double face : d’un côté, la hiérarchie exige des résultats chiffrés rapides, de l’autre, les équipes réclament reconnaissance, écoute et bien-être.
Ce tiraillement est une réalité quotidienne : si les chiffres baissent, même temporairement, c’est le manager qui en porte la responsabilité. Mais s’il impose une pression constante, il perd l’adhésion et l’engagement de ses collaborateurs.
Le cas du constructeur automobile : du bien-être à la performance… puis à la crise
Prenons l’exemple d’un manager qui reprend un service d’un constructeur automobile.
Au départ, l’équipe vit dans une ambiance conviviale. Les journées sont agréables, la solidarité existe… mais les résultats financiers sont catastrophiques. La direction s’impatiente et menace de restructurer. Le manager redresse la barre. Processus cadrés, indicateurs suivis, contrôle serré : la productivité décolle. À la présentation des résultats, la direction applaudit. Mais l’équipe explose. Plaintes de manque de considération, sentiment de n’être plus que des exécutants, départs en cascade.
Ce récit illustre deux impasses classiques du management moderne.
Quand on privilégie le bien-être au détriment de la performance
Un climat « sympa » mais sans exigence mène vite à une zone de confort stérile.
Sans résultats tangibles, l’équipe perd en crédibilité et se met en danger face à la direction. Les collaborateurs peuvent finir par s’ennuyer, se démotiver, voire craindre pour leur avenir si la rentabilité n’est pas au rendez-vous.
La bienveillance, mal comprise, devient une complaisance qui nuit au collectif.
Quand la performance prime au détriment du bien-être
À l’inverse, focaliser uniquement sur les chiffres génère stress, démotivation et turnover.
Les études confirment ce constat : lorsque le bien-être est sacrifié pour la performance, les conséquences sont sévères : burn-out, absentéisme, présentéisme, chute de l’innovation.
Comme l’a montré Google avec son projet Aristote, les équipes qui bénéficient d’un climat de confiance et de sécurité psychologique dépassent en moyenne leurs objectifs de 17 % – alors que celles privées de cette sécurité échouent de 19 %.
La conclusion est claire : la performance immédiate au prix de l’humain est une victoire à court terme… mais une défaite à long terme.
Bien-être et performance : deux forces interdépendantes
Performance et bien-être ne s’opposent pas.
Ils sont au contraire mutuellement renforçants :
Une équipe performante est fière de contribuer à un projet porteur de sens, ce qui nourrit son bien-être. Une équipe qui se sent reconnue, valorisée et écoutée est plus engagée et créative, ce qui améliore sa performance.
Richard Branson résume bien cette logique : « Prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise ». Virgin et d’autres pionniers de l’expérience collaborateur ont montré que cette approche crée un cercle vertueux bénéfique pour les salariés comme pour la rentabilité.
Comment sortir du tiraillement ?
Sortir de ce tiraillement suppose un réglage de focus permanent :
Côté hiérarchie : donner de la visibilité sur des résultats clairs et mesurables. Côté équipe : instaurer un climat de considération et de reconnaissance, en valorisant les efforts et pas seulement les résultats.
Quelques leviers concrets :
–Manager avec bienveillance et exigence : respect et écoute au quotidien, mais aussi courage d’adresser les problèmes de performance.
-Favoriser la sécurité psychologique : droit à l’erreur, feedback constructif, espaces de parole.
–Repenser le pilotage de la performance : feedback continu, fixation d’objectifs accessibles et clairs plutôt qu’évaluations stressantes.
-Mesurer et suivre le bien-être : baromètres internes, taux d’engagement, indicateurs de QVT au même titre que les KPI financiers.
–Former et soutenir les managers eux-mêmes : car un manager sous pression ne peut pas porter seul cette double exigence.
Conclusion
Le manager moderne n’a pas à choisir entre performance et bien-être. Son rôle est d’apprendre à articuler les deux, à répartir la pression entre hiérarchie et équipe, à maintenir un équilibre dynamique.
Car au fond, la performance durable naît du bien-être, et le bien-être authentique se nourrit de la performance.
🎯 Vous êtes manager ou DRH ?
Vous vivez ce tiraillement entre résultats et engagement ?
J’accompagne les managers et leurs équipes à transformer cette tension en levier de réussite.
Contact direct : Info@academie-des-hp.com • 0471 55 70 10